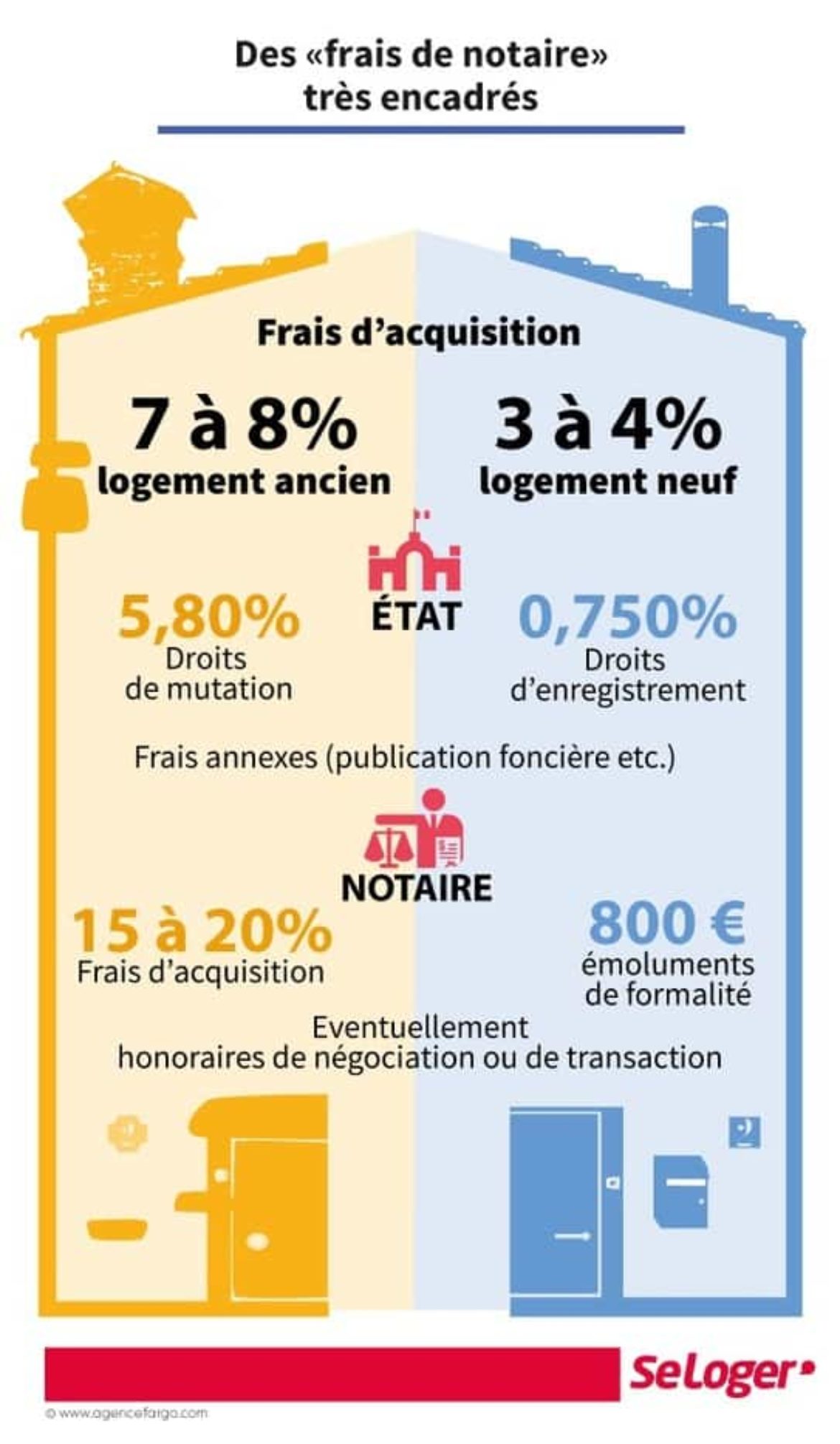Acheter un logement sur plan revient à signer un contrat en VEFA. Il est important de savoir ce qui est légal, obligatoire ou interdit, afin de vous assurer que vous achetez un bien immobilier en bonne et due forme.
Vérifiez le contenu du contrat de réservation du logement
Les versements prévus dans le contrat de réservation
Lorsque vous achetez un logement sur plan, vous êtes amené(e) à signer un contrat de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement). Mais ce contrat est lui-même précédé d’un contrat de réservation, dans lequel le promoteur vous réserve le logement que vous souhaitez acheter. Ce contrat fixe un prix prévisionnel, qui peut être majoré de 5 % lors de la signature du contrat définitif. Il peut également inclure une clause de révision qui ne peut excéder 70 % de la variation de l’indice national du bâtiment entre la date de signature du contrat de réservation et celle du contrat définitif. Le promoteur demande généralement le versement d’un dépôt de garantie qui doit s’élever à maximum 5 % du prix prévu dans le contrat de réservation si le contrat définitif doit être signé dans l’année, et 2 % si la vente est signée dans les 2 ans. Vérifiez que la somme soit versée sur un compte spécial à votre nom dans une banque ou chez un notaire.
Téléchargez notre guide
« Réussir son achat dans le neuf »
Certaines mentions doivent apparaître dans le contrat de réservation
Le contrat de réservation doit contenir certaines mentions obligatoires, telles que la date de livraison des travaux, le descriptif du logement, sa surface, la qualité de la construction, la localisation exacte du bien, le prix, etc. Sachez qu’un contrat de réservation peut être considéré comme nul s’il ne vous informe pas notamment de la surface habitable approximative, du nombre de pièces, du prix prévisionnel et des modalités de révision du prix, des conditions légales concernant le dépôt de garantie, de la date de signature du contrat définitif, etc. De même, le contrat de réservation doit contenir une condition suspensive légale d’obtention du prêt : ainsi, vous avez la garantie que la vente sera annulée si vous n’obtenez pas votre prêt, et que vous récupérerez le dépôt de garantie.
Vous devez connaître les conditions de rétractation
Légalement, vous bénéficiez d’un délai de 10 jours après la signature du contrat de réservation pour vous rétracter, et cela doit être mentionné dans le contrat. Le promoteur doit vous envoyer un exemplaire du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception, et vous avez la possibilité de vous rétracter dans les délais impartis en envoyant un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, vous récupérez alors intégralement le dépôt de garantie.
Conseil SeLogerNeuf
Mettez à profit le délai de rétractation pour tout vérifier : vous pouvez même faire appel à un avocat qui vous aidera à décrypter entièrement le contrat de réservation.
Vérifiez le contenu du contrat de vente définitif
Le contrat de vente doit être signé chez un notaire
A partir du moment où vous avez signé le contrat définitif, le promoteur ne peut plus en changer le contenu sans votre accord. Ce contrat doit être signé chez un notaire et doit également contenir un descriptif du logement, le prix, les modalités de paiement, la date de livraison, la garantie d’achèvement et de remboursement auquel le promoteur doit avoir souscrit. Le contrat comporte également des annexes avec de nombreuses indications obligatoires (le plan, les surfaces, le plan-masse, le cahier des charges, etc).
Le paiement du prix de vente est encadré
Le paiement du prix de vente est systématiquement échelonné au gré de l’avancement des travaux. Ainsi, vous devez avoir payé 2 à 5 % du prix au début de la construction, 35 % à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d’eau, 95 % à l’achèvement des travaux, et les 5 %, qui restent, sont versés lors de la remise des clés, si vous n’avez pas émis des réserves. Vérifiez donc que le contrat comporte bien ces modalités légales.
Bon à savoir
La loi prévoit également des pénalités en cas de retard de paiement, mais ces pénalités ne doivent pas dépasser 10 % du prix de vente.
Vérifiez les modalités de livraison et les garanties souscrites par le promoteur
La date de livraison du logement est fixe
Généralement, la date de livraison est en réalité une période, comme par exemple premier trimestre 2018. Le contrat prévoit généralement que le promoteur n’est pas responsable des dépassements des délais dus à des intempéries, à la faillite d’un sous-traitant, ou en cas de travaux supplémentaires que vous lui auriez demandés.
Vérifiez les modalités de livraison
Vous devez être convoqué(e) par lettre recommandée pour réceptionner les travaux, et vous devez également réaliser une visite avec le promoteur. Soyez très attentif(ve) lors de cette visite, afin de relever d’éventuels défauts de construction ou de conformité sur le procès-verbal de livraison. Si vous n’avez relevé aucun défaut, le promoteur est alors en droit d’exiger le paiement du solde du prix. En revanche, si vous avez relevé des défauts, vous devez les mentionner sur le procès-verbal, et vous pouvez consigner le solde sur un compte spécial à la Caisse des dépôts et consignations.
Vérifiez que le promoteur ait souscrit à certaines garanties
Après la réception des travaux, il est encore possible de demander des réparations au promoteur si vous constatez des défauts de construction, des vices de construction, des malfaçons, etc. Mais pour avoir l’assurance d’être couvert, vous devez vous assurer que le promoteur a souscrit à certaines garanties légales : la garantie d’achèvement qui vous assure de la construction complète de l’immeuble et la garantie de remboursement qui vous assure le remboursement des sommes versées au titre du prix de vente.
Sourced through Scoop.it from: edito.selogerneuf.com